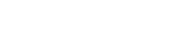Le Nigeria est, en termes de nombre d’enfants pris en charge, la plus grande réponse à une crise nutritionnelle jamais mise en place par MSF. Plus de 80 000 enfants atteints de malnutrition sévère sont pris en charge uniquement dans le cadre de notre action. Les stades les plus sévères de dénutrition concernent les enfants de moins de cinq ans. C’est gigantesque, même dans ce territoire qui connaît un problème de malnutrition de façon endémique depuis longtemps. Et dans cette zone déjà fragile, il faut rajouter l’actuelle épidémie de rougeole, les récoltes qui n’ont pas été extraordinaires, l’inflation qui est devenue très forte depuis le Covid… Tout cela, mis ensemble, place les familles dans des difficultés extrêmes pour se procurer de la nourriture, et les premiers à pâtir de la situation sont les petits enfants.
L’insécurité se traduit pour les populations par une difficulté d’accès aux champs et donc des récoltes moindres ; des vols dans les villages ; des enlèvements mais aussi des violences sexuelles sur les femmes.
L’idée que j’ai de MSF aujourd’hui est plutôt assez semblable à celle que j’en avais quand j’y suis entrée. La présence sur le terrain, auprès des populations, pour mettre en place des secours médicaux, dans des situations d’urgence, lors de conflits armés, à des moments de déstabilisation, est toujours au cœur de l’action de MSF. Aujourd’hui, les zones de guerre représentent environ la moitié de nos actions.
En 20 ans, la prise en charge médicale dans les projets MSF a beaucoup évolué. Nous avons des projets médicaux complexes comme de la chirurgie reconstructive ou de l’oncologie. On parlait de la malnutrition au Nigéria en début d’entretien, et prendre en charge 80 000 enfants atteints de malnutrition aiguë sévère était quelque chose d’inimaginable à la fin du vingtième siècle. A l’époque de la crise du Darfour ou de l’Angola par exemple, nous ne pouvions suivre que 3 000 à 5 000 enfants maximum.
On travaille avec des médecins généralistes et spécialistes. Nous sommes à la recherche de médecins spécialistes qui acceptent de partir pour des périodes longues (de 6 mois à 1 an), comme des gynécologues, pédiatres, anesthésistes etc. Aujourd’hui, le gros de notre activité hospitalière concerne les maternités, la pédiatrie et l’obstétrique. Enfin, pour continuer à progresser en médecine, je pense que nous devons faire évoluer notre relation avec nos patients, en les associant plus à leur plan de traitement, en leur déléguant une partie du soin. Des médecins formés aux approches centrées sur le patient seraient très utiles.
Propos recueillis par François Petty
Crédit photo : Agnès Varraine-Leca/MSF